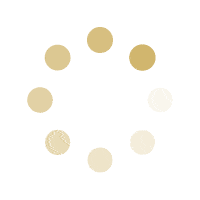- 5 juin 2025
- La scène parisienne
- Christophe Durastanti, Emma Houelle
Petit manuel d’initiation à l’opéra
Beaucoup pensent que l’opéra est réservé à une certaine élite, à quelques happy few. Nous aimerions avec ce blog changer cette idée communément admise.
L’opéra n’est qu’affaire de sensibilité. Il suffit de se laisser porter par la musique, l’histoire, les voix, sans oublier la mise en scène qui a autant d’importance que dans le théâtre. Un opéra se voit et s’entend.
Si tous ces éléments sont réunis, il est vraiment possible de passer une soirée extraordinaire, de se mettre en colère, de s’émouvoir et même de pleurer.
L’opéra est un spectacle total.
Bref, l’opéra se vit toujours très intensément, qu’il dure une heure, comme Barbe-bleue de Bartok ou bien vingt-neuf heures comme Licht de Stockhausen (cycle de sept opéras).
Avec ce petit manuel, nous aimerions vraiment vous donner le goût de l’opéra et faciliter votre compréhension de cet art qui ne doit pas faire peur mais qui est simplement fait pour émerveiller.
Tout d’abord, qu’est-ce que l’opéra ?
L’opéra est un genre musical qui allie musique, chant, mise en scène et parfois danse pour raconter une histoire. Il est né en Italie à la fin du XVIe siècle et a depuis connu une évolution étonnante à travers différents styles et écoles.

Petit lexique de l’opéra
- Aria : Air chanté par un soliste dans un opéra. Il exprime souvent les émotions d’un personnage à un moment clé. Exemple : « Nessun dorma » de Puccini.
- Bel canto : Style de chant italien du XVIIIe et XIXe siècle caractérisé par la beauté du timbre, la souplesse vocale et la virtuosité. Rossini, Bellini et Donizetti en sont les maîtres.
- Cavatine : Air lyrique, souvent court et expressif, chanté sans répétition.
- Colorature : Passages vocaux très ornés et virtuoses, typiques du répertoire soprano. Exemple : « Der Hölle Rache » dans La Flûte enchantée de Mozart.
(Continuez à lire pour découvrir ce qu’est la voix soprano !) - Duetto (ou Duo) : Morceau chanté par deux personnages.
- Finale : Dernière scène d’un acte, souvent spectaculaire et rassemblant plusieurs personnages.
- Intermezzo : Morceau instrumental joué entre deux scènes ou actes.
- Leitmotiv : Motif musical associé à un personnage ou une idée, très utilisé par Wagner.
- Libretto (Livret) : Texte de l’opéra, souvent écrit par un librettiste.
- Ouverture : Pièce orchestrale qui introduit un opéra.
- Recitativo (Récitatif) : Chant proche de la parole, utilisé pour faire avancer l’action entre les arias.
- Surtitres : Traductions projetées au-dessus et/ou sur les côtés de la scène pour aider à comprendre le texte chanté.
Savez-vous discerner les différents types de voix à l’opéra ? Lisez la suite pour en savoir plus…

Les différents types de voix féminines et leurs rôles
Il existe trois grands types de voix féminine :
★ SOPRANO
La voix de soprano est la voix la plus connue, c’est aussi la plus aiguë chez les femmes.
On peut citer comme grandes sopranos : Maria Callas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson, Leontyne Price, Lucia Popp, Gundula Janowitz, Anna Netrebko, Renée Fleming et Sonya Yoncheva. Cette liste n’est, bien sûr, pas exhaustive.
Écoutez ici Porgi Amor avec Gundula Janowitz
Souvent attribuée aux héroïnes, la soprano se retrouve dans des rôles comme celui de Violetta (La Traviata de Verdi) ou celui de la Reine de la Nuit (La Flûte enchantée de Mozart). Les opéras qui mettent en valeur les voix de soprano sont nombreux et comptent parmi les plus célèbres du répertoire lyrique. Ces rôles exigent souvent une grande virtuosité, une puissance vocale impressionnante et une capacité d’interprétation dramatique.
- Quelques opéras très célèbres avec des rôles de sopranos :
- • Lucia di Lammermoor, de Donizetti met en scène une soprano colorature dans la célèbre scène de la folie.
- • La Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée, de Mozart exige une tessiture aiguë et des vocalises redoutables.
Écoutez ici La Reine de la Nuit avec Lucia Popp. - • Dans Tosca, de Puccini, l’aria “Vissi d’arte” met en lumière l’intensité dramatique du rôle-titre.
- • Norma, de Bellini est un rôle extrêmement exigeant et nécessite une voix claire, pure et puissante pour chanter le fameux air « Casta diva ».
- • Madama Butterfly explore un registre plus lyrique et émotionnel avec l’air « Un bel di, vedremo ».
- • Rusalka de Dvořák et le fameux air de la Chanson à la lune, qui ressemble presque à une berceuse, nécessite une voix souple et claire.
★ MEZZO-SOPRANO
La voix de mezzo-soprano possède une tessiture plus grave que celle de soprano. Cette voix est souvent associée aux rôles de mère, de magicienne ou de rivale.
Quelques grandes mezzo-sopranos : Christa Ludwig, Marilyn Horne, Fiorenza Cossotto, Shirley Verrett, Janet Baker, Cecilia Bartoli, Elīna Garanča, Joyce DiDonato, Alice Coote et Marina Viotti. Là encore, la liste n’est pas exhaustive.
Les opéras mettant en avant les rôles de mezzo-soprano offrent des personnages souvent complexes, passionnés et dotés d’une grande profondeur dramatique. Contrairement aux sopranos, les mezzo-sopranos incarnent fréquemment des rôles de femmes fatales, de mères, de sorcières ou encore de jeunes hommes dans des rôles travestis.
Voici quelques exemples de personnages pour mezzo-soprano : Carmen de Bizet et Charlotte (Werther de Massenet).
- Quelques opéras avec des rôles de mezzo-sopranos :
- • Carmen, de Bizet est sans doute le plus emblématique, avec son héroïne libre et sensuelle qui chante la célèbre Habanera et la Séguedille.
- • Samson et Dalila, de Saint-Saëns met en valeur la voix envoûtante de Dalila avec « Mon cœur s’ouvre à ta voix », un des airs les plus célèbres du répertoire.
- • Dans La Cenerentola, de Rossini, Angelina (Cendrillon) brille par son agilité vocale et son expressivité, notamment dans « Nacqui all’affanno ».
Écoutez ici Marina Viotti dans La Cenerentola. - • Giulio Cesare, de Haendel met en scène Cléopâtre et Cornelia, deux rôles splendides où les mezzo-sopranos peuvent exprimer virtuosité et émotion.
- Les rôles travestis sont aussi courants :
- • Octavian dans Der Rosenkavalier, de Strauss en est un exemple marquant.
- • De même, Cherubino dans Les Noces de Figaro, de Mozart est un rôle charmant et espiègle à qui revient le fameux air si céèbre, « Voi che sapete ».
★ Contralto
Enfin, la voix Contralto est la voix féminine la plus grave et la plus rare, souvent réservée à des rôles de personnages imposants, comme Erda dans L’Anneau du Nibelung de Wagner).
Les grandes contraltos sont : Marian Anderson, Kathleen Ferrier, Ewa Podleś, Maureen Forrester, Nathalie Stutzman, Marie-Nicole Lemieux et Sara Mingardo.
Écoutez ici « Ombra mai fu » de Haendel
Les contraltos, la tessiture féminine la plus grave, sont souvent moins mises en avant que les sopranos ou les mezzo-sopranos, mais elles incarnent des rôles essentiels dans l’opéra. Leurs voix profondes et chaleureuses confèrent une intensité dramatique unique, souvent associée à des personnages maternels, surnaturels ou masculins dans des rôles travestis.
Ces rôles, bien que moins nombreux, permettent aux contraltos de déployer toute leur richesse vocale et leur expressivité
.
- Quelques opéras célèbres avec des rôles de contralto :
- • Orphée, dans Orfeo ed Euridice, de Gluck, souvent confié à une contralto, brille dans l’aria bouleversante « Che farò senza Euridice? »
- • Comme Ulrica dans Un Ballo in Maschera, une voyante mystérieuse chantant « Re dell'abisso ».
- • Madame Quickly dans Falstaff, qui apporte une touche comique avec « Reverenza! ».
- • Dans La Gioconda, de Ponchielli, la redoutable La Cieca incarne un rôle dramatique de mère protectrice.
- • Enfin, dans Rinaldo, de Haendel, la magicienne Armida est parfois confiée à une contralto pour sa tessiture profonde et puissante.

Les différents types de voix masculines et leurs rôles
Chez les hommes, il y a 4 types de voix :
★ Ténor
Le Ténor. La voix masculine aiguë, ils sont les héros lyriques par excellence. On peut noter les personnages de Rodolfo (dans La Bohème de Puccini) ou Don José (dans Carmen de Bizet).
Les opéras mettant en avant les ténors sont nombreux car cette tessiture incarne souvent les héros romantiques, les amants passionnés ou les figures tragiques. Les rôles de ténor demandent à la fois puissance, agilité et une grande expressivité.
- Quelques opéras célèbres avec des rôles de ténors :
- • La Bohème, de Puccini met en lumière le rôle de Rodolfo, dont l’air « Che gelida manina » arrive à un moment-clé de l’opéra, chargé d’émotions et de lyrisme.
- • Dans Tosca, le personnage de Cavaradossi brille avec « E lucevan le stelle », une aria déchirante.
Écoutez ici « Pacido Domingo E lucevan le stelle », extrait de Tosca. - • Chez Verdi, La traviata, offre au ténor le rôle d’Alfredo et l’occasion de briller avec « De' miei bollenti spiriti ».
- • Tandis que Rigoletto, offre au Duc de Mantoue le célèbre aria « La donna è mobile ».
- • Dans le répertoire belcantiste La Fille du Régiment, de Donizetti nous présente Tonio avec « Ah ! mes amis », un air redoutable comportant neuf contre-ut.
- • Enfin, Les Pêcheurs de perles, de Bizet offre à Nadir l’inoubliable « Je crois entendre encore », mettant en valeur la douceur et l’agilité de la voix de ténor.
Écoutez ici Roberto Alagna dans Les Pêcheurs de perles
★ Baryton
Le baryton possède une tessiture intermédiaire, souvent attribuée aux personnages complexes. Voici quelques exemples de personnages qui sont interprétés par des barytons : Scarpia (dans Tosca de Puccini) ou Figaro (dans le Le Barbier de Séville de Rossini).
Les barytons occupent une place essentielle dans l’opéra, incarnant souvent des personnages puissants et complexes : rois, méchants, pères autoritaires ou héros tourmentés. Leur voix, plus grave que celle des ténors mais plus claire que celle des basses, combine puissance, expressivité et élégance.
- Quelques opéras avec des rôles de baryton :
- • Il Trovatore, vous fera entendre le Comte di Luna dans le fameux air « Il balen del suo sorriso », un air d’une grande beauté lyrique.
- • Macbeth et Simon Boccanegra, sont d’autres rôles verdiens exigeant une grande profondeur dramatique.
- • Chez Mozart, Don Giovanni, résonnera longtemps à vous oreilles avec le célèbre « Fin ch’han dal vino ».
- • Dans Les Noces de Figaro, Mozart attribue à Figaro la voix de baryton pour incarner un personnage vif et expressif. Répérez l’air « Non più andrai » dans ce magnifique opéra.
- • Dans l’opéra, Faust, Gounod offre à Valentin l’air célèbre « Avant de quitter ces lieux ».
- • Enfin, dans Eugène Onéguine, Tchaïkovski emploie la voix de baryton pour l’air nostalgique « Kogda bï jizn ».
★ Basse
Cette voix est la plus grave et la plus souvent liée aux sages ou aux figures autoritaires. Les rôles de basse dans l’opéra sont souvent majestueux et imposants, incarnant des rois, des sages, des pères sévères ou des méchants redoutables. Leur voix grave confère une autorité naturelle, une puissance dramatique et parfois une profondeur psychologique impressionnante. Les grandes basses sont : Fédor Chaliapine, Nicolai Ghiaurov, Boris Christoff, Samuel Ramey, René Pape et Ferruccio Furlanetto.
- Quelques opéras célèbres avec des rôles de basses :
- • Philippe II dans Don Carlo, de Verdi, un rôle dramatique intense, avec l’air bouleversant « Ella giammai m’amò », exprimant solitude et désespoir.
- • Boris Godounov dans Boris Godounov, de Moussorgski, un rôle-titre exigeant, avec des scènes émotionnelles comme le Monologue de Boris.
- • Osmin dans L'Enlèvement au sérail, de Mozart, un rôle comique mais vocalement exigeant avec des graves redoutables (« O wie will ich triumphieren »).
- • Bartolo dans Le Barbier de Séville, de Rossini, un rôle comique et virevoltant, avec l’air célèbre « A un dottor della mia sorte ».
- • Don Magnifico dans La Cenerentola, de Rossini, le beau-père de Cendrillon, un rôle burlesque avec des airs exigeants.
★ Contre-ténor
Enfin, la voix de contre-ténor et quelques contre-ténors célèbres : Alfred Deller, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky ou encore Jakub Józef Orliński.
C’est souvent la voix qui étonne le plus quelqu’un qui va à l’opéra pour la première fois.
Le contre-ténor dans l'opéra et la musique baroque a souvent des rôles spécifiques qui tirent parti de la particularité de sa voix. Les contre-ténors sont souvent associés à des personnages aux traits androgynes, voire féminins, en raison de la douceur et de la clarté de leur voix. Ces personnages peuvent être des jeunes hommes, des esprits, des anges ou des divinités. Leur voix, très aérienne et légère, les rend idéaux pour incarner des rôles d’une grande pureté ou d’un caractère éthéré.
- Quelques opéras avec des rôles de contre-ténors :
- • Idoménée dans Idomeneo, de Mozart, un personnage tragique, souvent chanté par des contre-ténors dans certaines productions modernes.
- • Zoroastre dans Zoroastre, de Rameau, un personnage mythologique, chef de guerre et sage.
- • Arbace dans La clemenza di Tito, de Mozart, un rôle de personnage noble et céleste.
- • Le Roitelet dans Le Rossignol, de Stravinsky, un personnage céleste, souvent chanté par un contre-ténor.

Un aperçu historique de l’opéra
★ L’époque baroque
L’opéra naît avec L’Orfeo de Monteverdi en 1607. L’époque baroque voit l’essor de l’opera seria et de l’opera buffa, avec des compositeurs comme Haendel et Lully.
L'opéra baroque français, né au XVIIᵉ siècle, se distingue par son élégance, sa déclamation expressive et l'intégration de la danse et des chœurs. Jean-Baptiste Lully, père de la tragédie lyrique, impose un style où musique et texte servent le drame, comme dans Armide ou Atys.
Son successeur, Jean-Philippe Rameau, enrichit l’harmonie et l’orchestration, avec des œuvres comme Hippolyte et Aricie et Les Indes galantes, mêlant héroïsme et exotisme.
Contrairement à l’opéra italien, l’opéra baroque français privilégie le récitatif dramatique et évite les vocalises excessives. La danse y joue un rôle central, influencée par la tradition du ballet de cour.
D’autres compositeurs, comme Marc-Antoine Charpentier (Médée) et André Campra (L’Europe galante), contribuent à cet âge d’or. Ce style influencera l’opéra jusqu’à Gluck (1714-1787) et même Berlioz (1803-1869). Aujourd’hui, il retrouve sa place sur les grandes scènes avec des interprétations historiquement informées.
★ La période classique
À l’époque classique (au XVIIIe siècle), Mozart (1756-1791) révolutionne le genre et marque l’histoire de l’opéra par son génie mélodique, son sens dramatique et son habileté à donner une profondeur psychologique inédite à ses personnages. Il compose dans plusieurs styles : l’opera seria (opéra sérieux), l’opera buffa (comique) et le singspiel (avec dialogues parlés).
Il compose plusieurs opera seria, où il dépasse les conventions figées du genre en approfondissant l'expression dramatique des personnages. Idomeneo (1781) en est un exemple brillant. La Clémence de Titus (1791), dernière œuvre lyrique de Mozart, apporte une grande humanité aux protagonistes.
Il introduit dans l’opera buffa une profondeur psychologique et une richesse musicale exceptionnelle. Les Noces de Figaro (1786), sur un livret de Da Ponte, critique la société de son temps avec une rare finesse. Don Giovanni (1787) mêle comédie et tragédie dans un drame captivant. Cosi fan tutte (1790) explore les jeux de l’amour avec un équilibre subtil entre légèreté et mélancolie.
Ce grand compositeur brille aussi dans le singspiel, un opéra avec dialogues parlés, où il allie fantaisie et profondeur. L’Enlèvement au sérail (1782) impressionne par ses airs virtuoses et son orchestration riche. La Flûte enchantée (1791), œuvre quasi philosophique, mêle conte féerique et idéaux maçonniques, tout en exploitant les contrastes vocaux (la Reine de la Nuit s’oppose à Sarastro).
★ L’époque romantique
À la période romantique (au XIXe siècle), l’opéra se fait plus expressif et grandiose. Des compositeurs comme Verdi en Italie avec La Traviata et Aida et Wagner en Allemagne avec L’Anneau du Nibelung (regroupant L’Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux) vont marquer chacun la période de leur écriture musicale particulière.
Qu’est-ce qui distingue ces deux compositeurs ?
Giuseppe Verdi (1813-1901) et Richard Wagner (1813-1883) sont deux des plus grands compositeurs d’opéra du XIXe siècle. Bien qu'ils soient contemporains, leurs styles, philosophies et approches musicales diffèrent profondément.
Verdi incarne la tradition italienne du bel canto, mettant l’accent sur la mélodie et l’expressivité vocale. Ses opéras sont ancrés dans l’émotion et le drame humain, avec des mélodies immédiatement mémorables. Il privilégie des formes plus classiques et une orchestration qui soutient la voix sans l’écraser. Parmi ses œuvres majeures figurent La Traviata, Rigoletto et Aida, où le chant est roi et où le théâtre reste direct et accessible.
Wagner, en revanche, révolutionne l’opéra en développant le concept de Gesamtkunstwerk (œuvre d’art totale), fusionnant musique, poésie et mise en scène dans une continuité dramatique. Il abandonne les airs traditionnels pour le leitmotiv, un motif musical associé à un personnage ou une idée, créant une architecture sonore complexe. Son orchestration est dense et exigeante, transformant l’orchestre en acteur central. Ses œuvres majeures, comme Tristan und Isolde, L’Anneau du Nibelung et Parsifal, sont monumentales et souvent assez longue. Mais quel plaisir !
★ L’époque post-romantique
À la période post-romantique et moderne (début du XXe), Puccini compose des chefs-d’œuvre comme Madama Butterfly. Debussy, Strauss et d’autres renouvellent l’approche de l’opéra.
Richard Strauss (1864-1949) a eu un impact profond sur l'évolution de l'opéra, apportant des innovations musicales majeures et repoussant les limites de l'expression dramatique et orchestrale. Bien qu'il soit influencé par Wagner, Strauss a su forger un style propre, combinant une maîtrise de l'orchestre, une richesse harmonique et une exploration de la psychologie des personnages. Il a révolutionné l'orchestration de l'opéra. Son utilisation de l'orchestre comme un personnage à part entière, à la fois pour soutenir et commenter l’action, a transformé l’expérience opératique. Son orchestration dense et complexe a permis de créer des atmosphères intenses et nuancées. Des œuvres comme Salomé (1905) et Elektra (1909) font appel à un orchestre extrêmement riche et dynamique, où les instruments dialoguent avec les voix, souvent de manière frénétique, pour souligner les tensions psychologiques des personnages.
Ce compositeur a introduit une analyse psychologique plus poussée des personnages. Il a également contribué à la modernisation de la forme opératique en incorporant de nouvelles structures, allant au-delà des conventions de l'opéra traditionnel. Ses opéras, comme Der Rosenkavalier (1911), combinent un riche héritage de l’opéra romantique avec une nouvelle dimension : des influences de la comédie et des dialogues plus raffinés. En somme, Strauss a redéfini l’opéra en enrichissant le langage orchestral et en abordant des thèmes plus complexes dans lesquels les émotions et la psychologie marquent une étape décisive dans l’évolution de ce genre musical.
★ L’opéra contemporain
Avec l’opéra dit « contemporain », on note que l’opéra n’est pas un art qui reste ancré dans le passé mais qui a su évoluer. Les opéras modernes explorent de nouvelles formes musicales et thématiques, incorporant parfois des technologies multimédias.
- Quelques opéras contemporains :
- • Nixon in China, de John Adams, est un opéra captivant avec de la musique dite « minimaliste et répétitive ». Il met en scène la visite historique de Richard Nixon en Chine. Un opéra qui mêle politique et tensions personnelles. La musique y est très facile d’accès.
- • Lear, de Reimann, un opéra dramatique et psychologique qui plonge dans la folie du roi Lear. Il est inspiré de la tragédie de Shakespeare et présente une musique sombre et complexe. On frisonne à l’écoute de cette musique très expressive et parfois « violente » et syncopée.
- • Le Grand Macabre, de Ligeti, un opéra grotesque et surréaliste, fusionnant comédie noire et réflexion sur la mort, dans une satire de la condition humaine. Génial et très loin d’être aussi « macabre » que son titre l’indique.

Les opéras parisiens n’attendent que vous !
On espère que ce blog aura répondu à quelques-unes de vos questions et qu’il vous aura donné envie de pousser les portes de deux opéras parisiens, celles, grandioses et historiques, du Palais Garnier et celles, nettement plus contemporaines, de l’Opéra Bastille. Vous y passerez, à coup sûr, une soirée d’exception. Le mot n’est pas trop fort. On vous l’assure ! Les soirées à l’opéra sont des soirées « hors du temps ».
Nous ajouterons que contrairement au théâtre, l’opéra peut être également entendu et vu sans mise en scène. Il s’agit alors d’opéras en version concert. Ce procédé est à privilégier si vous souhaitez vous concentrer sur la musique et les voix. L’orchestre et le chœur sont sur la scène et les chanteurs viennent chanter leurs airs à tour de rôle ou ensemble. Ce type d’opéra permet de découvrir une œuvre dans toute sa splendeur orchestrale et vocale.
Que vive l’opéra pour nous émerveiller tous encore longtemps !
Un cadeau inoubliable…
Vous souhaitez faire un cadeau à un ami et… vous n’avez pas d’idée, vous hésitez entre plusieurs choses ! Grâce à notre bon cadeau, vos amis pourront choisir eux-mêmes leur cadeau dans notre liste de spectacles, de concerts, de cabarets ! Voilà qui leur permettra de passer une soirée vraiment inoubliable dans la capitale.
ET IL Y EN A ENCORE BIEN PLUS À DÉCOUVRIR...
Que vous soyez un fan aguerri ou que vous ayez une envie de découverte, la newsletter de Theatre in Paris saura vous aiguiller ! Une fois par mois ou plus, vous recevrez un e-mail spécialement rédigé par nos soins avec notre sélection du moment, nos meilleurs conseils, les promotions en cours, et bien plus !
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok en cliquant sur le lien ci-dessous pour voir notre page Link in Bio...